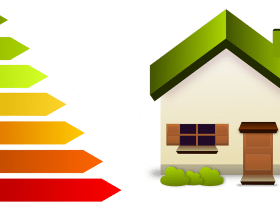Le numérique a un impact notable sur les émissions de gaz à effet de serre et la consommation des ressources, en grande partie à cause du rythme soutenu de fabrication des équipements. En France, il représente environ 2,5 % de l’empreinte carbone nationale, dont une grande majorité liée à la production des terminaux. Adopter une approche de sobriété numérique — prolonger la durée de vie des appareils, ajuster le stockage, modérer le streaming et concevoir les services de façon plus sobre — permet de réduire l’empreinte environnementale tout en améliorant l’usage quotidien des outils numériques en accord avec la loi REEN et les objectifs de transition écologique.
Impact environnemental du numérique
L’impact environnemental du numérique ne se limite pas à l’électricité utilisée par les centres de données : il couvre tout le cycle de vie des dispositifs et services, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à leur traitement en fin d’usage. En France, l’ADEME et l’Arcep ont établi que le numérique représentait environ 2,5 % des émissions nationales en 2020, avec une hausse portée entre autres par les usages audiovisuels et les échanges internationaux de données. Cette part s’accompagne également d’une contribution mesurable à la consommation d’électricité (environ 10 % en 2022 pour les services numériques), ainsi que d’effets sur les ressources en eau et en matières premières, tout particulièrement pour les technologies à forte intensité comme l’IA.
La plus grande part de l’empreinte carbone du numérique provient de la fabrication des équipements (téléphones, ordinateurs, téléviseurs, objets connectés), représentant environ 78 % des émissions du secteur, contre environ 21 % pour leur usage et une faible part pour leur fin de vie. Cela montre que faire durer les produits dans le temps et modérer leur renouvellement sont des leviers importants. Cette répartition s’explique par les processus industriels énergivores, nécessitant des ressources diverses comme des métaux rares, souvent en quantité infime mais avec une empreinte écologique importante.
À l’échelle mondiale comme locale, la progression des usages numériques (haute définition, stockage massif en ligne, IA temps réel) augmente la demande en énergie et en ressources matérielles. L’ADEME met en évidence l’intérêt d’agir sur la durée d’utilisation des équipements via des actions de réparation, de réemploi ou de reconditionnement, mais aussi sur les services numériques pour limiter les volumes de données, l’énergie nécessaire à leur circulation, et la charge sur les infrastructures. Adopter la sobriété ouvre une voie vers un numérique plus responsable, sans pour autant restreindre le potentiel d’innovation.
Solutions pour réduire l’empreinte écologique
La sobriété numérique se traduit par des choix et comportements pragmatiques, tant à l’échelle personnelle qu’en entreprise, pour modérer l’impact environnemental du numérique. Voici certaines options considérées comme les plus efficaces selon les observations de l’ADEME et de l’Arcep.
Prolonger l’usage des équipements.
C’est l’un des moyens les plus influents. Opter pour des produits réparables, donner priorité aux appareils reconditionnés, préserver l’état des batteries (éviter les charges complètes fréquentes ou la chaleur), changer certains composants plutôt qu’un appareil entier, et maintenir les mises à jour de sécurité. En entreprise, définir un renouvellement basé sur les besoins réels plutôt que sur une régularité systématique contribue à limiter l’impact environnemental.
Réévaluer le stockage et la gestion des données.
L’enregistrement systématique sur des serveurs distants engendre de la redondance et maintient en ligne des fichiers inutiles. Adopter des règles de conservation sélectives, recourir au stockage à froid, supprimer les fichiers volumineux ou obsolètes, compresser les médias, éviter les doublons : toutes ces pratiques contribuent à une gestion plus sobre en énergie au niveau des infrastructures d’hébergement.
Ajuster les habitudes de streaming.
Regarder en très haute définition sur un petit écran n’apporte pas toujours un réel avantage visuel. Adopter une qualité vidéo adaptée, limiter la lecture automatique ou les vidéos diffusées en parallèle permet de réduire à la fois la consommation électrique et le volume de données sollicitées.
Revoir la conception des services numériques.
Des pages légères, des fichiers image ajustés à l’usage, l’utilisation du cache, ou encore des requêtes simplifiées : autant de bonnes pratiques de conception qui réduisent la charge sur les serveurs et la consommation côté utilisateur. Pour les services, la mutualisation, le dimensionnement à la demande, ou encore le suivi des performances sont des actions qui participent à cette approche plus mesurée de la conception numérique.
Définir des pratiques d’achat et de gouvernance plus réfléchies.
Introduire des critères liés à la réparation ou au reconditionnement des dispositifs dans les procédures d’achat, encadrer les règles d’usage et sensibiliser les équipes sont des étapes utiles pour faire évoluer les comportements au sein des organisations, en cohérence avec les orientations de la transformation écologique et les directives de la loi REEN.
Une ressource visuelle disponible en ligne permet de visualiser concrètement les gestes utiles et l’ampleur de leur effet :
« Dans notre petite copropriété, nous avons choisi de conserver les ordinateurs existants plutôt que d’en acheter de nouveaux. Une vérification a montré que pour environ 70 % des postes, il suffisait d’ajouter de la mémoire et un SSD. Un nettoyage du stockage en ligne et une politique de conservation sélective des fichiers ont permis de diviser par trois le volume des sauvegardes hebdomadaires. Bénéfice : dépenses contrôlées, ordinateurs plus fluides, et satisfaction d’avoir réduit l’impact environnemental sans action technique complexe. Le principal défi était plutôt de modifier les habitudes. »
Tableau de synthèse des approches ayant un effet notable :
| Usage numérique | Émissions de CO₂ estimées | Mesures recommandées |
|---|---|---|
| Fabrication smartphone | Majorité des émissions (~78 % à la production) | Allonger l’usage, réparer, reconditionner |
| Stockage cloud | Variable selon quantité, doublons et durée | Nettoyage régulier, archivage, tri des contenus |
| Streaming vidéo | Selon qualité, temps passé et connexion | Qualité adaptée, limiter lecture automatique, téléchargement hors-ligne |
| Utilisation d’applications | Dépend de l’optimisation des interfaces et des serveurs | Conception allégée, cache efficace, scripts réduits |
Ces recommandations s’appuient sur des données validées par l’ADEME, insistant sur la nécessité d’allonger la durée d’usage des appareils et d’adopter une approche plus réfléchie de la conception numérique.
Dimensions sociales et comportementales
Certains comportements liés à nos usages intensifs — multiplateforme, notifications, absence de tri — entraînent un surplus de données transportées et stockées, augmentant en retour l’impact environnemental. Mettre en place des règles plus simples (réduction des alertes, organisation des fichiers, désactivation automatique des vidéos) peut à la fois limiter les effets néfastes sur l’environnement et améliorer le quotidien.
Cette démarche s’étend également à la manière de penser la connexion : choisir une qualité audio quand la vidéo n’est pas nécessaire, rassembler les actions en ligne sur un moment plus court, ou encore activer les fonctionnalités hors-ligne. À plus grande échelle, les organisations peuvent promouvoir ce type d’approche à travers campagnes internes, règles d’usage collectives, ou formations spécifiques.
Côté production, intégrer des interfaces simples, éviter les animations imposantes, afficher les contenus de manière progressive sont des solutions qui ont un double effet : accessibilité renforcée et consommation énergétique limitée. Cela rejoint les préconisations officielles en matière de sobriété dans la conception numérique.
Cadre légal et réglementaire
La loi REEN, en France, oriente les efforts vers plusieurs axes : permettre aux usagers de devenir plus conscients, favoriser les équipements réparables, offrir des services numériques modérés, et mieux suivre les actions publiques ou privées dans ce domaine. Cette législation vise à structurer l’engagement envers un usage plus mesuré de la technologie.
Les démarches initiées à l’échelle européenne poursuivent les mêmes objectifs — par exemple via l’économie circulaire ou les ajustements réglementaires liés aux coûts énergétiques — avec une portée plus large. Le point commun reste l’intérêt pour des stratégies qui misent sur la durée d’utilisation des terminaux et une vision mesurée dans le développement technologique.
Il s’agit d’une série d’actions visant à limiter l’impact environnemental des technologies en intervenant sur les équipements (réparation, réemploi) ainsi que sur les services (conception plus légère, régulation des flux de données), pour prévenir la surconsommation de ressources.
– Utiliser ses appareils plus longtemps, remplacer les composants au lieu de changer d’équipement.
– Faire régulièrement le tri dans les fichiers enregistrés, désactiver la lecture automatique, choisir la qualité HD lorsque la 4K est superflue.
– Réduire le nombre de services connectés actifs.
– Préférer les achats orientés vers des équipements réparables ou issus du reconditionnement, limiter le remplacement régulier du matériel.
– Développer des services réduisant la charge réseau, supprimer les données devenues inutiles.
– Mettre en place des indicateurs pour suivre la consommation et définir des objectifs progressifs.
Oui, surtout au format 4K sur des réseaux non adaptés. Régler automatiquement les vidéos sur des résolutions intermédiaires peut avoir un effet concret sur la consommation.
Parce que leur phase de fabrication implique une part très importante de l’effort environnemental global. Leur cycle de remplacement rapide augmente encore cet impact, alors qu’ils pourraient généralement servir plus longtemps.
Le numérique a une empreinte qui découle fortement de la fabrication des équipements et du volume grandissant des flux de données. Les actions les plus concrètes concernent la prolongation de la durée d’utilisation des terminaux, une conception plus simple des services numériques, une gestion raisonnée du stockage, et des usages ajustés. La loi REEN accompagne ces dynamiques. Dans l’ensemble, une meilleure maîtrise des pratiques techniques et comportementales peut contribuer à faire évoluer le numérique dans une direction moins impactante.
Sources de l’article :
- https://spote.developpement-durable.gouv.fr/nos-thematiques/sobriete-numerique/
- https://www.notre-environnement.gouv.fr/actualites/breves/article/les-bonnes-pratiques-de-la-sobriete-numerique